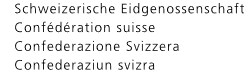Sécurité
Politique de sécurité
La politique de sécurité suisse protège le pays et sa population contre les menaces et les dangers, et contribue à la stabilité et à la paix au-delà des frontières.
Renseignement
Le Service de renseignement de la Confédération protège la Suisse par la prévention, l'analyse de la situation et la détection précoce des menaces pour la sécurité du pays.
Armée suisse
L'armée suisse défend le pays, soutient les autorités civiles en cas de besoin et promeut la paix internationale.
Cybersécurité et cyberdéfense
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports protège la Suisse contre les cyberattaques et soutient la gestion des incidents cybernétiques.
Guerre en Ukraine
Analyse de la crise en Ukraine et de ses impacts sur la Suisse: informations sur la sécurité et le soutien humanitaire.